
" Relations concurrentielles entre les réseaux saint-simoniens et le monde littéraire "
(Exposé de Philippe Régnier, transcription par Emmanuelle Cullmann)

" Relations concurrentielles entre les réseaux saint-simoniens et le monde littéraire " : ce titre doit être précisé, au risque d’une fausse interprétation : qu’il y ait un monde littéraire n’est pas tout à fait sûr, peut-être y en a-t-il un certain nombre, plusieurs fractions. Il existe un monde saint-simonien mais ces réseaux sont aussi en partie des réseaux littéraires aussi. On parlera de relations d’homologies, parfois même de mimétisme entre la ou les sociabilités saint-simoniennes et les sociabilités littéraires de la première moitié du XIXe siècle.
Ainsi, les relations entre Sainte-Beuve et Lamennais relèvent-elles de la sociabilité de la littérature ? On peut difficilement y répondre par la négative, sauf à projeter sur cette période une représentation de la littérature marquée par la rupture Baudelaire/Flaubert, idéologie qui veut qu’il n’y ait littérature qu’à partir du moment où il y a intention purement esthétique - définition qui exclurait de la littérature par exemple les trois quarts du XVIIIe siècle. L’autre difficulté est le désordre de la République des Lettres dans cette première moitié du XIXe : les salons, les académies, qui étaient ce qu’on connaissait de bien structuré, sont bousculés, les journaux et les revues n’ont pas encore l’importance qu’ils auront par la suite. Les groupes littéraires eux-mêmes semblent difficiles à saisir, même quand il s’agit du Cénacle.
Première période : 1825-1832
On considère le point de départ que constitue l’apparition dans le monde intellectuel du saint-simonisme de la revue Le Producteur. Ce n’est pas une revue littéraire, mais elle veut parler d’industrie du point de vue d’une culture, et imposer l’idée qu’au-delà du problème de la production il y aurait celui d’une réorganisation de la société, d’où la question qui surgit fin 1825-début 1826 de la nécessité d’une nouvelle doctrine générale. Cette question est explicitement liée à celle d’un pouvoir spirituel puisqu’Auguste Comte qui, à cette époque n’a pas encore rompu avec les saint-simoniens, donne au Producteur une série d’articles qui tournent tous autour de cette notion.
Cette idée dans Le Producteur suscite immédiatement la réaction concurrentielle d’un groupe littéraire emmené par Benjamin Constant et Stendhal. L’un et l’autre, dans les salons d’abord, puis dans Le Globe, puis dans le pamphlet de Stendhal D’un nouveau complot contre les industriels, réagissent avec une très grande vigueur. Plusieurs arguments sont invoqués, et par exemple l’idée que les gens du Producteur voudraient réduire les poètes à chanter les machines. Un autre argument, directement lié à notre sujet, est qu’ils voudraient être de nouveaux prêtres de Thèbes et de Memphis. Constant et Stendhal, en revanche, tiennent pour une conception que l’on pourrait appeler " protestante " de la littérature, sans doctrine ni dogme, où les écrivains seraient des combattants mais sans idéologie commune, sans doctrine générale, sans religion : des combattants laïques. En somme l’opposition qui se lit, au-delà du débat d’idées, est l’opposition entre deux conceptions de la littérature. L’une, qui est à la fois catholique et néo-jacobine, où la littérature ne constitue - ni plus ni moins que l’écriture sainte - des textes de référence qui doivent servir de guide à la société, par opposition à la conception, qui est celle de Constant et de Stendhal, selon laquelle la littérature est quelque chose d’essentiellement critique. Or c’est dans le même Producteur qu’est assimilée la dernière idée de Saint-Simon, selon laquelle il serait important de constituer une nouvelle Église, de promouvoir de nouveaux apôtres et d’imiter, ou de rejouer les Pères de l’Église et les premiers chrétiens, les apôtres étant les artistes suprêmes, puisqu’ils parlaient, ce qu’ils disaient pouvait être fixé par écrit, et ce qu’ils disaient et écrivaient entraînait l’ensemble de la société. On retrouve ce qu’évoquait B. Degout : Sainte-Beuve précisant le sens religieux du Cénacle : c’était en 1829, après ce dont il est ici question. De fait, à peine le Producteur coulé - en 1828-1829 - les saint-simoniens se constituent en Eglise et décident d’instituer entre eux l’appellation de père, mère, frère, sœur. C’est à la même époque que, en relation avec Ballanche, ils tentent de l’entraîner à prophétiser au-delà de ce qu’il fait, et à être leur auteur attitré. Ils voudraient avoir avec lui une relation privilégiée, eux constituant le public, public réactif, et Ballanche trouvant chez eux la puissance nécessitée pour composer non seulement une relecture du passé, ce qu’il fait déjà, mais une prédiction de l’avenir. On voit bien dans la correspondance cette tentative de constituer avec lui un groupe qui serait non seulement politique mais littéraire, les deux choses étant indissociables. Cela contre la conception libérale et de la société et de la littérature. La démarche est si conséquente que, tout en prononçant une exposition de la doctrine saint-simonienne, en référence explicite à la doctrine chrétienne de Bossuet, les saint-simoniens, à la faveur de la crise politique de Juillet 1830, se paient le luxe de racheter le lieu même d’où étaient parties les flèches contre eux, à savoir Le Globe, grâce à Pierre Leroux converti, et à Sainte-Beuve converti également pour quelques mois.
Donc non seulement il y a la théorie d’une cléricalisation des écrivains laïques, mais il y a le début d’une pratique, cela aussi bien par conversion des artistes extérieurs, que par conversion des saint-simoniens eux-mêmes à l’écriture. Et s’ils ne fondent pas à l’époque de sociétés industrielles, les saint-simoniens produisent du texte, et cela énormément. Au point que la bibliographie de Fournel, faite en 1833, bibliographie du saint-simonisme pour la période 1825-1833, est un petit livre. Il y a des périodiques : Le Producteur, L’Organisateur, Le Globe ; des brochures qui font livre, comme celle de Jeanne Deroin, des recueils d’articles du Globe, tout cela constitue une production textuelle massive, pas toujours commercialisée, quelquefois distribuée gratuitement - en particulier les brochures du Globe. En 1830 les saint-simoniens investissent intellectuellement et physiquement l’hôtel de Gèvres où s’imprimait Le Globe, peu après que Emile Barrault, le plus littéraire d’entre eux, a publié, avec un fort contrôle idéologique des Pères suprêmes, une sorte de manifeste intitulé Aux Artistes. Du passé et de l’avenir des beaux-arts (1830). Il y appelle les écrivains, les artistes, musiciens aussi bien que poètes ou architectes, à devenir prêtres. Ce texte est bien connu ; on en rappelle la conclusion, elle-même très rhétorique. Cela se présente comme un œuvre de prosélytisme qui refuse la littérature, mais en même temps c’est très écrit :
Viennent, viennent donc à nous tous ceux dont le cœur sait aimer et le front s’enflammer d’une noble espérance. Associons nos efforts pour entraîner l’humanité vers cet avenir. Unis entre nous comme les cordes harmonieuses d’une même lyre. Commençons dès aujourd'hui ces hymnes saints qui seront répétés par la postérité. Désormais les beaux-arts sont le culte, et l’artiste est le prêtre.
On arrive donc à une fusion entre artiste profane et apostolique.
Il ne suffit pas à la nouvelle Église d’occuper Le Globe même, les locaux sont à la fois le lieu communautaire où vivent les dirigeants, mais le lieu où ils accueillent des réunions qui sont à la fois de propagande et de réjouissance : on y joue du piano, on y chante, on y danse, en même temps qu’on y écoute la bonne parole. On réalise déjà cette réunion des arts que l’appel de Barrault réclamait, cette réunion qui dans l’esprit des saint-simoniens était le propre de l’Eglise du Moyen Age avant que le théâtre ne s’en dissocie et que ne s’institue une division entre art sacré et art profane. Avec une grande cohérence, donc, les saint-simoniens instituent aussi des prédications, auxquelles ils invitent systématiquement les étoiles montantes de la littérature : on a trace d’une invitation faite à Victor Hugo par Pierre Leroux - le jour même où l’orateur devait parler de lui -, on a trace aussi de la présence de Michelet qui en est demeuré très impressionné. Les saint-simoniens sont donc vraiment à ce moment-là des producteurs littéraires et des artistes, intégrés dans la production elle-même, à la base : on pourrait s’étendre sur leurs relations avec les imprimeurs et les libraires de l’époque : ce sont des producteurs de littérature. Cela dans le premier temps : 1825-1832.
La rupture de 1832
En 1832, il y a une rupture, due en particulier à la répression : le pouvoir a enfin compris que ces gens-là faisaient de la politique sous couvert de religion ou de débat d’idées, et il leur tombe dessus, en même temps que sur les républicains. Un des problèmes de l’époque, et Le Globe l’illustre bien, c’est qu’il est difficile d’établir l’endroit où se situe la frontière entre littérature et politique, pour des raisons légales de timbre, bien sûr - on paie plus cher pour un journal politique -, mais en même temps parce que lorsqu’on avance des idées nouvelles, qui n’entrent pas dans les cadres intellectuels des partis, dans le débat libéraux/légitimistes, on fait de la littérature. Cela n’est pas reçu comme du politique. Et donc, pendant les premiers lendemains d’après Juillet 1830, ce que font les saint-simoniens est reçu comme un ensemble doctrinal intéressant, de la théorie, de la religion, mais cela finit par inquiéter à partir du moment où ces idées descendent dans les quartiers ouvriers de Paris, paraissent être reçues de manière subversive, et donc entrer dans la politique de la rue. C’est à ce moment que le gouvernement de Casimir Périer intervient brutalement pour fermer les salles de prédication des saint-simoniens, interdire les rassemblements, en même temps les ressources financières s’épuisent et ils sont obligés d’arrêter Le Globe.
Deuxième période, à partir de 1832 - l’expérience de Ménilmontant.
D’où cette deuxième étape, qui est celle où les saint-simoniens se prennent encore plus pour des artistes, et où on a infiniment de mal à les distinguer d’autres groupes de Jeunes-France. On en arrive à l’expérience de Ménilmontant.
En 1832, Enfantin décide d’embarquer une quarantaine de personnes - chiffre sacré - à Ménilmontant, colline, sur les hauteurs, cela évoque un peu le retrait sur l’Aventin des tribuns de la plèbe, dans une grande propriété bourgeoise qu’il tient de son père, banquier qui a connu son heure de fortune, en pleine campagne. Là ils vont essayer d’instituer directement leur culte : on passe du stade des projets à celui des réalisations. On commence par se passer de domestiques - ce qui signifie abolir l’exploitation de l’homme par l’homme ; on écarte les femmes, ce qui peut être interprété de manière anti-féministe comme féministe, en tout cas la version officielle est qu’on arrête de les exploiter ; on cultive le jardin, on construit un théâtre de verdure ; on organise des cérémonies dominicales où on invite le public. Les apôtres qui entourent Enfantin ne sont pas choisis au hasard. Il y a bien sûr les ingénieurs et les médecins qui constituent le fond militant du groupe, mais il y a en même temps, et c’est nouveau, une proportion importante d’artistes, pas forcément très connus. Le plus connu est Félicien David, qui deviendra compositeur sous le Second Empire ; Raymond Bonheur, le père de Rosa, lui-même artiste peintre ; Machereau, caricaturiste un peu connu dans le milieu de la caricature ; Pol Justus, un peintre. On pourrait ajouter Achille Rousseau, un poète ouvrier, Alexis Petit, dessinateur. Ces gens sont choisis intentionnellement par Enfantin pour donner une image artistique de Ménilmontant et pour participer eux-mêmes à la création du culte : en dessinant, en composant de la musique, des chants. C’est donc une réalisation exacte de cette fraternité des arts qui est un des motifs importants de l’idéologie Jeune-France. L’institution du costume peut-être lue également comme une intention d’homologie avec les costumes romantiques qui fleurissaient à même époque dans les milieux Jeune-France : entre le gilet rouge ou rose, selon les versions, de Théophile Gautier, son pantalon vert-d’eau brodé de noir et ses cheveux mérovingiens, ou encore la barbe de Pétrus Borel, ou encore le pourpoint noir lacé par derrière de Jehan du Seigneur. On aurait, si on faisait un tableau complet des costumes portés par les Jeunes-France, une image un peu différente de cette jeune littérature de la première moitié du XIXe. Les saint-simoniens créent eux-mêmes leurs costumes
(Ont été mis en circulation des extraits de catalogue, des gravures en couleur de ces costumes : costume de Bousingots, deux versions de costumes saint-simoniens - il y en a eu plusieurs)
Il y a la barbe, le côté médiéval, le côté oriental, l’intention de transparence qui affiche l’identité de l’apôtre sur sa poitrine, brodée, il y a surtout une volonté de différencier les artistes saint-simoniens par rapport au monde extérieur. Et ce mot d’ " artiste " doit s’entendre lui-même dans un sens qui est à mi-chemin entre celui du journal L’Artiste et celui de la fin du XVIIIe où l’artiste est cet homme de l’art qui n’est pas un théoricien de la chimie ou un théoricien de la physique, mais quelqu'un qui a cette habileté, pas toujours théorisée mais reconnue comme essentielle dans la société.
 |
L’hypothèse est que dans cette sociabilité des saint-simoniens à Ménilmontant, on a tous les éléments que l’on retrouve chez les Bousingots, dont Pétrus Borel se dit le grand prêtre, et un peu moins dans le groupe de Théophile Gautier et de Nerval, celui de la Bohème de la rue du Doyenné. Et si l’on examine ce que font les artistes de Ménilmontant, on s’aperçoit qu’ils font délibérément de l’art expérimental : ils font du théâtre total, en plein air, tantôt en intégrant à leur spectacle le canon qui tonne à Saint-Merry pendant qu’ils chantent, tantôt en intégrant le soir le spectacle des étoiles, tantôt en faisant le procès verbal de leurs discussions nocturnes et en produisant des textes qui sont à la fois des essais théoriques, des dialogues, qui ne sont ni véritablement le dogme définitif, achevé, ni véritablement des formes fictionnelles déconnectées d’une action militante. Par exemple un essai de genèse, une réflexion sur la métaphore, des essais poétiques. Ce sont donc des essais de pratiques d’écriture, parfois de littératurisation de l’oral, qui se présentent tout à fait comme une tentative de créer des pratiques littéraires nouvelles, collectives, y compris dans la forme. |
On verra bien plus tard dans le siècle d ’autres groupes qui auront l’ambition d’avoir avec la littérature un rapport qui soit, plutôt qu’un rapport à des jeux d’écriture, un rapport à l’existence, et un rapport transformateur à l’existence . Cette littérature est à la fois une littérature qui se lit et qui s’écrit, et une littérature qui se vit : qui se porte sur soi, sous forme de costume, et se vit dans la pratique. Non seulement on imagine la fusion intellectuelle de l’Orient et de l’Occident, mais on va en Orient, en groupe, peu après avoir imaginé de grandes transformations cosmogoniques par le rapprochement de l’Orient et de l’Occident. Donc il y a aussi d’une certaine manière, dans la relation avec le voyage et avec l’Orient une homologie totale, pas seulement avec Chateaubriand dont la carte sert aux voyageurs pour leur itinéraire, pas seulement avec Lamartine qui s’y trouve en même temps, mais il y a la mise en place d’un modèle de voyage. A telle enseigne que Maxime Du Camp et Flaubert tomberont chez Lambert, au Caire, une dizaine d’années plus tard.
C’est le point maximum où la sociabilité saint-simonienne et la sociabilité littéraire de type nouveau que tentent le groupe de Pétrus Borel et, dans une moindre mesure peut-être, le groupe de Gautier et Nerval, s’identifient parfaitement. Cela ne dure pas au-delà de 1834-1835. A partir de là, les choses changent complètement.
De 1834-1835 à 1848 : l’activité journalistique
Le groupe saint-simonien éclate, en individus, en sous-groupes, et ce qu’il y avait de collectif se réinvestit seulement dans la création commune ou la collaboration commune à des périodiques. L’activité littéraire des différents groupes ou réseaux saint-simoniens va passer pour l’essentiel par l’écriture journalistique. L’osmose entre les réseaux enfantiniens disséminés et les réseaux littéraires se mesure par exemple à la pénétration du journal L’Artiste. Dans les premières années de L’Artiste, la présence de deux anciens journalistes du Globe saint-simonien, comme Joncières et surtout le gendre de Bazard, Alexandre Saint-Chéron, est importante. On peut évoquer aussi comme point de rencontre une revue comme L’Europe littéraire, lancée par Jules Lechevalier qui prétend mettre en place un " Parti social ", entreprise à laquelle Victor Hugo par exemple, mais il n’est pas le seul parmi les gens de lettres connus, donne sa caution. On relève d’autres participations à différents journaux : le Journal des Débats, La Presse.
 |
La tentative la plus intéressante est celle de Pierre Leroux, avec la Revue indépendante. Leroux se résout à créer un organe de presse nouveau lorsqu’il a épuisé les possibilités de la Revue encyclopédique et lorsque la Revue des Deux Mondes qui s’était proposée pour accueillir ses articles, se ferme à lui. C’est précisément à ce moment-là qu’il rencontre George Sand et qu’il obtient son appui financier et de plume. Elle va collaborer en donnant des feuilletons et en écrivant des articles - pour créer une " revue indépendante ", indépendante par rapport à la presse disons " bourgeoise " - c’est évidemment la Revue des Deux Mondes surtout qui est visée. Cela n’est pas seulement la création d’un nouvel organe de presse : c’est la création d’un collectif, d’un point de rassemblement, qui se présente comme une petite société, militante, beaucoup plus que comme une entreprise commerciale ou un organe de presse comme ceux qui existent à ce moment-là. D’autant que dans la rédaction se retrouvent beaucoup d’anciens militants et que Leroux donc, mobilise, pour faire marcher sa revue, des forces qui ne sont pas attirées par l’appât du gain mais par des objectifs politiques partagés avec lui. On sait que, de la Revue indépendante à la Revue sociale ensuite, c’est ce même modèle social de groupe militant qui se développe, jusqu’à donner la communauté de Boussac - où non seulement on écrit mais on imprime : on fait de l’industrie littéraire au sens le plus littéral du mot, et on essaie ce faisant de mettre en pratique un modèle de société, de micro-société, de type socialiste. |
A partir de 1848
1848 et le coup d’état de Décembre bouleversent complètement la donne. Mais, et c’est une nouvelle hypothèse : est-ce que la façon dont fonctionne le groupe d’exilés autour de Victor Hugo, et la présence sur la même île de Leroux, est-ce que cela n’exprimerait pas une même conception, chez Leroux et Hugo donc ? Une conception héritée des mêmes pratiques de Ménilmontant, de la Revue sociale, de la Revue indépendante, qui consiste à fonder un petit groupe militant fortement soudé autour de la personne d’un patriarche, dont la production principale est une production textuelle, littéraire, et qui fonctionne comme une petite secte, mélangeant le lien militant et le lien familial. Le groupe de Leroux est sociologiquement très intéressant : il y a les frères, les gendres, mais les gendres ont épousé les filles parce qu‘il y a communauté d’idéologie, et tout ce monde fonctionne en ateliers, écrit et pense plus ou moins collectivement et a pour principal objectif de produire du journal, et ils font cela bien à l’écart de la société, en situation d’exil matérialisée par le caractère insulaire de leur résidence. Qui imite l’autre ? dans quel sens fonctionne le mimétisme ? On ne saurait trancher mais il semble qu’il y a même à distance un rapport étroit entre ce mode de fonctionnement du groupe de Leroux et ce mode de fonctionnement du groupe de Victor Hugo. L’un comme l’autre prennent plus ou moins origine dans les pratiques instituées à Ménilmontant. C’est une hypothèse, dont les réactions diront si elle est probable ou si elle ne l’est pas.
Parallèlement à cette hypothèse un peu extrême, il faut évoquer d’autres types de relations sociales qui mettent en scène les saint-simoniens et les écrivains contemporains.
Ce qui vient d’être décrit n’exclut pas des formes bien plus traditionnelles, et par exemple des sociabilités de salon. Par exemple on sait que les relations avec George Sand sont passées par le salon d’Aglaë Saint-Hilaire, qui était une amie d’Enfantin mais aussi une artiste, ou par le salon du docteur Curie, l’ancêtre de l’atomiste, où George Sand et le chansonnier Béranger fréquentaient en même temps que des saint-simoniens de bonne famille. Là, les relations que les militants essayaient d’établir avec George Sand ou avec Béranger étaient téléguidées par correspondance par Enfantin, qui poussait donc à établir une relation.
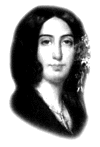 |
Autre forme de relation qui part de pratiques bien connues mais aboutit à des choses un peu plus originales : les tentatives de correspondance des saint-simoniens avec les grands écrivains. On connaît des gens qui fréquentent les mêmes salons, on appartient à peu près tout de même au même monde, et du coup on s’autorise à correspondre. On a ainsi des correspondances d’Enfantin avec Lamartine, Michelet ou avec Hugo, de même pour Gustave d’Eichthal, il suffit d’ouvrir l’édition de la correspondance par Lubin pour le vérifier aussi avec George Sand, on a aussi des relations sociales avec un réseau saint-simonien assez dense puisque beaucoup sont directeurs de journaux. Enfantin et Eichthal, l’un et l’autre, écrivent en ordre dispersé et ne se parlent presque plus, mais la démarche est la même : il y a tentative des grands apôtres pour instrumentaliser les grands écrivains, il s’agit de leur demander de participer à un mouvement prophétique. |
Puisqu’ils disposent d’une audience importante, on leur demande de l’utiliser pour dire des choses sur l’avenir, et par exemple celles qui leur sont suggérées, mais qui sont au fond la vérité de ce qu’ils disent déjà, et qui ne font que développer, en somme, des pensées qu’ils ont déjà, simplement de manière un peu incohérente, pas assez logique. Une fois qu’on a eu cette correspondance, au minimum on la conserve et on l’archive pour l’avenir, et au maximum, si on a un peu plus d’audace, on la publie - à la limite sans l’autorisation de l’auteur. C’est ce qu’Enfantin fait, par exemple, dans sa correspondance avec Michelet, dans les années 1840. Dans cette relation, à la différence de ce qu’il se passe dans les groupes décrits précédemment autour de revues, il semble que s’institue une différence entre - le terme est anachronique - l’idéologique et le littéraire en ce sens que, aussi bien Enfantin que Gustave d’Eichthal ou que Charles Duveyrier, qui pratiquent cette méthode, se posent en penseurs et opposent à cette posture qui est la leur celle des écrivains dont le rapport avec le public serait beaucoup plus facile, beaucoup plus immédiat. Eux-mêmes ne se reconnaissant plus la capacité d’influencer directement un public pensent que les écrivains peuvent être des relais privilégiés et devenir des porte-parole conscients, de manière utile pour leur propre métier d’écrivain. Donc on passe d’une situation où il y avait tentative d’occuper exactement le même terrain, avec les mêmes pratiques et en produisant pareillement du texte, à une situation où on est en relation d’inspirateur à inspiré - quelquefois de concurrent mais de concurrent malheureux, puisqu’alors même que Victor Hugo arrive à assumer à la fois le métier d’écrivain et la fonction de prophète, Enfantin est réduit à la situation de prophète qui n’a pas été entendu, obligé de se faire passer pour un simple industriel et donc de conserver simplement en archive les prophéties qu’il voulait délivrer.