
Bernard DEGOUT, " Les écrivains et le Sacre (1825) "

" Clovis, avec ses Francs et son pigeon descendu du ciel " : par cette expression pour le moins désabusée, irrévérencieuse, consignée à Reims juste avant le sacre de Charles X, Chateaubriand fait évidemment allusion à la colombe qui apporta dans son bec une fiole contenant l’huile sainte, lors du baptême de Clovis. Cette intervention divine répondait à une situation tout à fait concrète : le concours du peuple était si nombreux, si pressant, qu’il n’était pas moyen à Rémy de se faire apporter normalement l’huile destinée au sacrement. La colombe a remédié à l’inconvénient présenté par cette manifestation d’une sociabilité enthousiaste et envahissante, et, simultanément, permis que cette sociabilité ne soit pas remise en cause : il ne fut point nécessaire de disperser la foule pour que le baptême eût lieu.
Cet événement miraculeux avait été précédé d’un autre : on lit dans le récit qui fixa le mythe du baptême de Clovis qu’alors que Saint Rémy se trouvait dans l’oratoire du roi, avec la reine Clotilde, en compagnie de quelques clercs, de serviteurs et d’officiers de la maison, " Dieu, pour fortifier la parole sainte de son fidèle serviteur, daigna montrer ostensiblement que, suivant sa promesse, il est toujours au milieu des fidèles réunis en son nom " : apparut en effet une lumière merveilleuse, prélude à l’irruption de la colombe apportant au prélat la sainte ampoule ( Relation rédigée par le chanoine rémois Flodoard au milieu du Xe siècle, citée par Jacques Le Goff, " Reims, ville du sacre ", dans Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, " Quarto, 1997, t.I, p.657 ).
Sainte-Beuve n’a sans doute jamais lu ce récit quand il écrit son poème du Cénacle, publié en avril 1829. On ne peut donc considérer que comme fortuite cette " rencontre textuelle " qui lui fait placer en épigraphe de son poème cette phrase : " Quand vous serez plusieurs réunis en mon nom, je serai avec vous " - phrase qui se trouvait dans tous les catéchismes, tous les missels. La connotation religieuse du poème est du reste à l’avenant : tout comme à Reims, dans l’oratoire, quatorze siècles plus tôt, l’esprit saint descend dans la réunion de la rue Notre-Dame des Champs. Mais au-dehors ne se réunit pas un peuple enthousiaste : ce n’est plus une foule fervente mais une foule pharisienne qui fait affront au " poète saint, apôtre du mystère ". C’est aux premiers chrétiens réunis dans les catacombes qu’il est fait référence, association antérieure à la fin du Ve siècle. On est en face d’une ambition crypto-fondatrice de " s’approprier le siècle ", de faire " tomber Jéricho" ( Sainte-Beuve, Poésies complètes, Paris, Charpentier, 1840, p.56-59). C’est ce qu’a moqué Latouche dans son article d’octobre 1829 sur la " Camaraderie littéraire " : " Il se sera rencontré une petite société d’apôtres qui, se disant persécutée dans les principes d’un nouveau culte, s’est enfermée en elle-même pour s’encourager. Les apôtres se seront aimés ; car on commence toujours par s’aimer dans les catacombes […] Une congrégation de rimeurs bizarres est devenue un complot pour s’aduler et quelques confidences d’écoliers qui s’essaient à une conspiration flagrante contre des illustrations consacrées. Que si vous n’étiez pas doué à un très haut degré qui produit l’extase, nous ne vous conseillerions pas d’aborder jamais cette réunion qui s’est dit à elle-même que " le siècle lui appartient ", qui s’appelle modestement un Cénacle et trouve dans son sein ses martyrs et ses divinités " (Revue de Paris, t.VII, p.102, cité d’après Ségu, Latouche, p.349-350).
 |
Le terme de
" Cénacle " a fait florès, au point
que l’on est en droit de se demander si son
apparition n’est pas tardive, en regard de ce
qu’il entend désigner. C’est du reste ce que
va affirmer Sainte-Beuve lui-même, tant en employant le
terme à propos de la réunion qui se tenait chez Emile
Deschamps à l’époque de la Muse française,
qu’en indiquant, dans son " Victor Hugo en
1831 " qu’il avait mis quelque
empressement à employer, à propos de la réunion de le
rue Notre-Dame-des-Champs un terme qui ne désignait que
ce qui en elle, et de façon marginalisée, survivait du
cercle de la Muse :
|
Pourtant, dès le 2 janvier 1827, dans Le Globe, Sainte-Beuve avait cité un article de Soumet publiée dans La Muse : " Les lettres sont aujourd’hui comme la politique ou la religion ; elles ont leur profession de foi, et c’est en ne méconnaissant l’obligation qui leur est imposée que nos écrivains pourront se réunir, comme les prêtres d’un même culte, autour des autels de la vérité, ; ils auront aussi leur sainte alliance. " (Massin, II, p.1586)
Les variations, sinon les reniements, de Sainte-Beuve sur le sujet mériteraient une analyse particulière, mais il s’agit ici de s’appuyer sur le postulat que si le terme apparaît en 1829 il faut s’en tenir là et considérer qu’il y a quelque chose de significatif à ce que ce soit seulement à cette date là qu’une réunion littéraire comme il en était tant, ait hissé un pavillon aussi exalté, se soit nommée non plus par référence directe à l’hôte ou à l’hôtesse de la réunion, ni par référence à une revue, mais par un vocable qui désigne l’assomption, et le monopole de l’assomption, d’un héritage qui n’est rien d’autre que celui du Christ, héritage transmué en art.
Ce serait de la sorte, c’est l’hypothèse, opérer un saut qualitatif, par lequel une réunion d’hommes d’art s’est autoproclamée l’héritière des premiers chrétiens réfugiés dans les catacombes, dans une singulière répétition de la Cène. Ambition crypto-fondatrice, si l’on peut dire, et ambition de la réunion autour d’une trace, transmuée en présence par le fait même de la réunion.
*
"Le sacre de l'écrivain"
Plus personne, aujourd’hui, ne s’étonne de pareille exaltation, dont Paul Bénichou a recensé les attestations sous le pavillon du " Sacre de l’écrivain : 1750-1830 ; essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne ".
Peut-être ne s’étonne-t-on pas assez, et il est opportun d’être attentif à l’emploi que fait P. Bénichou de ce terme de " sacre " qui, lui aussi, a fait florès.
Ce que représente de relativement paradoxal l’emploi de ce terme a été pointé, notamment par Tzvetan Todorov et Marc Fumaroli. Le premier écrit :
" Lorsque les poètes voudront détrôner le pouvoir spirituel religieux, ils chercheront à ressembler aux prêtres (…) Mais l’euphorie sera de courte durée. Très rapidement, les poètes sont contraints de déchanter : leur appel n’a pas été entendu. Et, d’une certaine façon, il ne pouvait pas en être autrement : le poète voulait arracher au prêtre son rôle, sans s’apercevoir que, entre-temps, on avait changé de pièce. " L’élévation du poète au rang de guide spirituel [remarque P.Bénichou] suppose justement que le temps du sacerdoce, au sens propre du mot, est passé ". Aucune instance spirituelle comparable à l’Eglise chrétienne ne se dresse, dans les Etats modernes, à côté des détenteurs du pouvoir temporel ". ( T. Todorov, Présentation, dans Mélanges sur l’oeuvre de Paul Bénichou, textes réunis par Tzvetan Todorov et Marc Fumaroli, p.16-17)
De son côté, M. Fumaroli remet lui aussi, d’une certaine manière, le terme en cause : " la France gallicane, qui dans sa lutte contre Rome a sapé les fondements sacrés de sa propre royauté, a inventé un pouvoir spirituel laïque, qui est sa littérature (…) La chute de la royauté et de l’Eglise gallicane, dans la tragédie de la Révolution, ont créé les conditions favorables à la pleine mise en lumière de ce pouvoir spirituel laïque, qui n’a plus désormais en face de lui que des pouvoirs temporels et désacralisés, et une Eglise repliée sur Rome (…) C’est ce que Paul Bénichou a appelé presque par antiphrase ‘le sacre de l’écrivain’ " (M.Fumaroli, Hommage, dans Mélanges, op.cit., p.34)
J.-L.Diaz a creusé plus avant cette question :
En fait, la véritable sacralisation de l’homme de lettres qui a lieu à partir de 1760 suppose une double évolution. Et il faut dire que ce mot de " sacre ", particulièrement polyvalent, a l’avantage d’en désigner conjointement les deux aspects, même s’il risque aussi de les confondre. D’une part, on assiste en effet à l’interruption du long mouvement de " décri " qui s’en est pris aux diverses figures de l’intellectuel pendant tout l’âge classique. " Sacre " veut dire alors simplement " consécration ", " valorisation ", au lieu de dévaluation et de mépris (…) D’autre part, on remarque que ce phénomène de valorisation coïncide avec une accession fantasmatique de l’homme de lettres au pouvoir spirituel. Et dans ce sens, " sacre " veut dire cette fois " intronisation ", " couronnement symbolique ", conquête par l’écrivain méprisé et rejeté d’une responsabilité à la fois spirituelle et sociale(…) . (J.-L.Diaz, L’écrivain dans l’histoire, dans Mélanges, op.cit., p.72-73)
Plus précisément encore, à l’intérieur de ce double mouvement, la Révolution va marquer une coupure d’où naîtra, pris dans ce mouvement mais étape distincte, la figure du " Poète " qui est au " digne magistrat de la littérature, paternellement conscient de sa responsabilité sociale ", ce qu’est une " âme solitaire et blessée, à la fois surhomme et paria " à un " homme de savoir et de pensée " (ibid. , p.76-77) accueilli dans les salons aristocratiques (ibid. , p.73). De l’homme de lettres, le poète procède moyennant une " double rupture épistémologique " (ibid. , p.77) : celle de l’autonomisation, à l’intérieur d’un espace qui a perdu l’assurance d’être celui de la République des Lettres ; celle de la subjectivation, le poète ne se pouvant plus penser comme un être " générique ", " transindividuel " (ibid. , p.79), mais singulier - c’est influence, acceptée ou répudiée, peu importe ici, de Rousseau. Et J.-L.Diaz suggère que P.Bénichou " a peut-être un peu majoré la part du modèle proprement religieux dans le sacre de l’écrivain. Pouvoir spirituel ne veut pas dire forcément pouvoir religieux " (ibid. , p.82).
Ces différents points de vue soulignent une question : c’est qu’au moment de la Restauration que l’aspiration est la plus échevelée au sacerdoce poétique ; c’est alors que le modèle religieux est le plus prégnant (et il faut se souvenir de l’incroyable propension de l’époque à béatifier à tour de bras : la duchesse de Berry est une nouvelle Marie, la duchesse d’Angoulême est une sainte - recouvrant le fait qu’on a tenté en vain d’obtenir du pape qui avait sacré Napoléon la béatification du roi-martyr) ; mais, simultanément, c’est à ce moment là aussi qu’il montrerait le plus sa relative viduité : le fait, pour reprendre l’image de Todorov, que le poète s’assied sur un trône qui a disparu.
A dire cela, on pourrait donner l’impression que la France est déchristianisée, et qu’elle ne vit plus la religion qu’à travers des formes, dépourvues de contenu : perdurance d’un discours partout répété mais auquel plus personne ne croit vraiment. Il faut cependant songer, à partir des dernières années du règne de Louis XVII, et plus encore sous celui de son frère, à l’importance, à l’omniprésence des représentants du cléricalisme politique. Les contemporains ne pouvaient pas considérer que la place de l’Eglise était vacante. Dira-t-on alors que le message évangélique n’était plus qu’ânonné, et que la carence ainsi manifestée ouvrait précisément la porte à une tentative de réappropriation d’une ambition évangélique par les poètes ? Que dit d’autre, finalement, et pris au pied de la lettre, le poème du Cénacle, sinon que c’est dans cette réunion-là (sous-entendu : pas ailleurs) que les langues de feu dansent au-dessus des fronts, indiquant par-là qu’une étape nouvelle dans la conscience de soi des hommes de lettres et des artistes a été franchie dans les dernières années du règne, à l’époque de la chute du ministère Martignac ? Dans l’idée que ses participants se font de cette réunion, avec le Cénacle apparaît une forme nouvelle de sociabilité, pas très éloignée de ce que nous avons connu depuis au titre des avant-gardes.
L’hypothèse est que le sacre occupe dans le mouvement de cette conscience de soi un rôle tout à fait déterminant. S’il y a bien eu Cénacle, c'est-à-dire un saut qualitatif, sacralisation, le sacre de Charles X occupe une importance majeure. C’est le moment où l’Eglise a montré sa présence, s’est appuyée sur sa tradition. En d’autres termes, on considère ici qu’en dépit des reniements de Sainte-Beuve, on ne peut pas faire d’usage rétrospectif du terme de Cénacle. On doit au contraire être attentif au fait qu’il apparaît en 1828-1829 pour désigner une réunion dont l’hôte et le personnage central est Victor Hugo, le " génie qui nous rallie et nous guide " (Sainte-Beuve, Le Cénacle. Victor Hugo est le Dieu de cette réunion (lettre de Deschamps du 17 avril 1828) qui enjoint Vigny en 1828 à " serrer les rangs " autour du " bataillon sacré "), mais qu’à son nom propre on a préféré une dénomination commune ; qu’il ne s’agit pas d’une réunion exclusivement littéraire, mais artistique, et que de surcroît elle proclame que c’est la réunion des personnes (d’où le nom commun) qui va rendre présent ce qui, à défaut de pareille réunion, ne l’était pas.
Il faut donc examiner en quoi l’Eglise a convié la poésie au sacre, en quoi le saut qualitatif a pu s’opérer.
Or le sacre, de l’avis de la très grande majorité des historiens, se solda par un échec. Certes, la cérémonie rémoise, au dire de Victor Hugo dans une lettre à Adèle, fut " enivrante " ; et dans l’ensemble c’est l’impression qu’elle a produite, sous réserve de certains incidents, sur la majorité des assistants, ou du moins est-ce là le témoignage qu’ils ont voulu en laisser. Le sacre toutefois ne se résume pas aux événements rémois. Il faut prendre en compte tout un ensemble de manifestations dont la plus importante, passée la cérémonie, est l’entrée du roi à Paris au retour de Champagne. Or celle-ci fut plutôt morne et triste. La monarchie avait manquait à reprendre son origine en elle-même, selon la formule de Chateaubriand en juillet 1825.
Dès le 8 mai, juste avant le sacre, Vigny écrivait à Hugo : " Je vous plains de vous séparer de la moitié de votre âme [Adèle], pour aller voir nos cérémonies de carton et de papier peint, et toutes les grandeurs étriquées de notre temps. "
 |
Dans le journal qu’il rédigea pendant cette période, inséré ultérieurement dans les Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand écrit n’avoir assisté qu’à la représentation d’un sacre, et en rajoute en disant que c’est à Berlin, lors d’une représentation de la Jeanne d’Arc de Schiller qu’il a pu voir la cathédrale que de misérables décorations dissimulaient lors de la cérémonie. La vérité de l’Eglise est à Berlin. De même Hugo, lorsqu’il reviendra sur la cérémonie dans les pages plus ou moins dictées à Adèle, introduira lui aussi un élément théâtral en insistant sur la découverte faite à Reims, en marge de la cérémonie, du théâtre de Shakespeare : vrai théâtre contre faux théâtre. |
On avait déjà critiqué au XVIIIe le sacre de Louis XVI en le qualifiant d’opéra. Mais le thème prend sous la Restauration une tonalité nouvelle. C’était cinquante ans plus tôt la dépréciation d’une cérémonie dépourvue de sacré, moquerie de ce qui ne correspondait plus à l’état des mœurs, et la critique du sacre au nom du théâtre renvoyait l’Eglise à ce qu’elle refusait. Ici la cérémonie est dépréciée non pas dans son principe mais dans son déroulement, et cela au nom de l’art : on trouve dans les pages de Chateaubriand ce qui peut être tenu pour les didascalies d ‘une représentation réussie. Autre formulation de l’hypothèse énoncée plus haut, on en serait à remontrer à la monarchie et à l’Eglise que l’art leur est supérieur en tant que lieu et vecteur de la vérité, du spirituel.
A cette manifestation, la poésie a été conviée. On parlera bien entendu d’œuvres de circonstances, péjorées ou minimisées par cette dénomination même, œuvres intéressées, ou bien compensations, et on songe à Victor Hugo, notamment, qui venait d’être élevé dans l’ordre de la Légion d‘honneur. Mais cette idée de poèmes de circonstances est limitée : en 1825, la monarchie n’est pas en mesure de produire de discours clair à propos du sacre. Le sacre est une évidence, mais muette. Elle ne s’accompagne pas d’une parole positive, mais essentiellement négative. Un historien légitimiste a souligné par exemple, que mis à part la question du serment, l’ordo du sacre a uniquement fait l’objet de retranchements : on n’a pas su, ou pu, ou voulu introduire d’éléments nouveaux.
La parole poétique doit venir combler cette lacune. Quand Hugo, de Reims, écrit, le 28 mai, que Sosthène de La Rochefoucauld lui dit " que le Roi avait demandé si j’étais ici. Je suis effrayé de ce qu’ils attendent de moi ", il montre qu’il a très bien compris les enjeux qui pèsent sur lui.
*
La charte de 1814
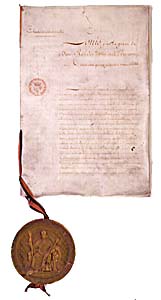 |
On trouve dans la Charte de 1814, en
son article 74, une parfaite illustration du problème
posé par le sacre à la monarchie restaurée. Le Sénat impérial proposa dès le 6 avril un texte baptisé " Constitution impériale ", que Louis XVIII, par la Déclaration dite de Saint-Ouen, le 2 mai, écarta, le jugeant inacceptable en l’état. Mais il réunissait une commission chargée de mettre au point une Constitution libérale. On connaît trois versions antérieures du texte constitutionnel : elles ont été publiées et commentées par Pierre Rosanvallon ( La Monarchie impossible, les Chartes de 1814 et de 1830, Paris, Fayard, 1994, p.25). L’essentiel, pour ce qui nous concerne ici, est que dès la première mouture figure l’idée, ainsi libellée dans la première mouture que : " Le Roi et ses successeurs jureront dans la solennité de leur sacre d’observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle ". L’article ne figure pas dans la troisième mouture mais se retrouve 74e et dernier dans la Charte octroyée, dans sa dernière partie intitulée " Droits particuliers garantis ", partie dont Vitrolles comme le R.P. de Bertier de Sauvigny critiquèrent le caractère brouillon et confus. |
C’est assez dire que la Charte, toute octroyée qu’elle était, rencontrait dans la question du sacre une difficulté, qui ne porte pas sur le caractère sacré du roi : les quatre textes contiennent la même formule selon laquelle " La personne du roi est inviolable et sacrée ". C’est dans la relation entre le sacre et la Constitution que se pose le problème.
En 1830, la prescription du serment à la Charte ne présente pas la même difficulté que celle rencontrée en 1814 : le roi ne tire pas son pouvoir de l’ordre divin, mais du peuple ou des Chambres, il est donc raisonnable que le serment à la Charte soit prêté devant les représentants du " peuple français " : la personne commise à remplir une fonction fait serment, devant ses commettants, de la remplir conformément aux principes par ces derniers définis.
L’article de 1814 comporte une dimension différente. Le Constitutionnel en pointe l’ambiguïté, avec une intention polémique manifeste : " Le sacre est subordonné à la Charte en même temps qu’il est adopté par elle. L’article 74 en a donc fait une solennité constitutionnelle " (Cité par J.-P. Garnier, Charles X, le roi, le proscrit, Paris, Fayard, 1967, p.74)
Le sacre est soumis à la Charte comme autorité prescriptive, mais en même temps il est quelque chose de bien supérieur, qui dépasse la Charte et influe sur elle en retour. S’esquisse un problème considérable : comment une instance peut-elle, dans le même mouvement, être soumise au texte qui la mentionne et simultanément représenter un principe supérieur, apportant à ce même texte qu’il n’est pas à lui seul capable d’apporter ?
Les deux premières versions du texte constitutionnel de 1814 portaient en leur premier article " Le gouvernement français est monarchique en son principe et la couronne héréditaire de mâle en mâle dans la maison de France (…) ". Un procès-verbal de la première réunion de la commission de rédaction de la Charte, daté du 22 mai 1814, avance que M. de Montesquiou, après lecture de cet article, " dit que huit siècles ont proclamé que la France est une monarchie, que vingt ans de révolution ne peuvent infirmer une pareille sanction, que l’histoire parle plus haut que toutes les constitutions" (Cité par P.Rosanvallon, op.cit., p.234), réponse qui aurait été inspirée par Louis XVIII : " Le roi octroyait la charte qui ne pouvait donc définir qui il était " (Cité par P.Mansel, Louis XVIII, p.196). " M. Boissy d’Anglas répond qu’il ne voit pas pourquoi on ne déclarerait pas dans la Charte ce qui existe en fait ; (…) " (Cité par P.Rosanvallon, op.cit., p.234). Montesquiou ne voulait pas que la constitution absorbât la monarchie, et il l’emporta sur le point de l’article premier. Ce ne fut pas le cas sur le sacre.
Mais dès lors qu’il existait une Constitution, dès lors que doit y prêter serment un roi au demeurant sacré, on ne voit pas d’autre moment pour ce serment que celui de la solennité du sacre. Le roi sacré aurait-il pu prêter serment devant les Chambres, comme ce sera le cas en 1830, et prêter un autre serment lors du sacre ? C’eût été admettre un serment supérieur à celui prêté à la Charte. La voie choisie s’énonce comme suit dans le préambule de la Charte : " Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons devant l’assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cette Charte constitutionnelle, nous réservant d’en jurer le maintient, avec une nouvelle solennité, devant les autels de Celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations. ". Un indéniable engagement, donc, mais rapporté à un autre, supérieur, pris devant Celui qui juge aussi bien les rois que les Chambres, c'est-à-dire devant qui ceux qui reçoivent en ce jour l’engagement de fidélité sont eux aussi comptables.
Restait donc le sacre, comme pierre angulaire de l’édifice, devant, avec une " nouvelle solennité ", c'est-à-dire à la fois une autre solennité et une solennité sans comparaison avec celle de l’engagement pris devant les Chambres, marquer l’intangibilité du serment à la Charte, aussi bien pour le monarque en exercice que pour tous ses successeurs.
Le non sacre de Louis XVIII
Or Louis XVIII n’avait pas été sacré bien que dès 1814 il en eût manifesté l’intention. Il envisagea différents lieux, et avait prévu d‘entrer dans la basilique déjà couronné : on avait examiné l’ensemble du cérémonial en en supprimant les parties qui mettent le roi dans une position gênante.
C’est à l’état de santé de Louis XVIII que l’on impute le plus souvent, et le plus vraisemblablement le fait qu’il ne s’est pas fait sacrer. Néanmoins, cela généra plusieurs interprétations, et notamment une légende. Selon celle-ci, le paysan beauceron nommé Martin, visité par l’ange Gabriel, aurait, au cours de l’entrevue que lui accorda Louis XVIII le 2 avril 1816, transmis au monarque un clair avertissement : il mourrait s’il se faisait sacrer, parce qu’usurpateur de Louis XVII qu’il devait s’employer à retrouver. On raconte aussi que le pape Pie VII s’opposa au sacre tant que Napoléon serait vivant.
Le fait que Louis XVIII ne fut pas sacré eut en tout cas des conséquences, apparemment contradictoires. D’un côté, la cohésion nationale autour de l’acception de la Charte fait défaut, la cérémonie du sacre ayant manqué à sa solennisation. Cette cohésion est de plus en plus délicate, tandis que les combats doctrinaires se font de plus en plus violents. De l’autre la nécessité du sacre s’est affaiblie en regard de la monarchie constitutionnelle. De fait, si les institutions ont continué à fonctionner, c’est qu’un roi a pu régner sans être sacré. Le caractère indispensable du sacre est devenu plus difficilement perceptible, tandis qu’on répandait le bruit que c’est par sagesse politique, à partir d’une certaine finesse dans l’appréciation de son temps, que Louis XVIII avait préféré surseoir. Cela portait tort au sacre de Charles X, le plaçant devant la réputation de ne rien comprendre à son temps. Cela affaiblit aussi la monarchie puisque, légende dorée de Napoléon naissant et se développant, le sacre de celui-ci pèse de plus en plus lourd sur le présent : un peu comme si les monarques de la Restauration n’étaient plus à même de porter la couronne de Charlemagne.
Polémiques autour du sacre de Charles X
 |
A la mort de Charles X
lui succède le comte d’Artois, ce qui provoque des
inquiétudes : c’est un ancien libertin, lié
à la Congrégation, tardivement rallié à la Charte et
réputé très enclin à accorder à l’Eglise un
pouvoir que beaucoup jugent exorbitant. Dans son discours d’ouverture de la session des chambres, prononcé le 22 décembre 1824, Charles X déclara : " Je veux que la cérémonie de mon sacre termine la première session de mon règne. Vous assisterez, messieurs, à cette auguste cérémonie. Là, prosterné au pied du même autel où Clovis reçut l’onction sainte, et en présence de celui qui juge les peuples et les rois, je renouvellerai le serment de maintenir et de faire observer les lois de l’Etat et les institutions octroyées par le roi mon frère ; (…) " (Moniteur, 23 décembre 1824, p.1643) Cette dernière expression a déclenché un scandale : elle n’est pas synonyme de " Charte ". Jusqu’au dernier moment personne ne savait s’il prêterait serment à la Charte. L’étonnant est que Charles X a remis le texte de son serment dès mai, et néanmoins on a laissé les polémiques sur les intentions du roi se déchaîner. Les esprits ne s’apaisèrent - provisoirement - que lorsque, le jour de la cérémonie, il prêta le serment de " gouverner conformément aux lois du royaume et à la Charte constitutionnelle (…) " ( extrait du serment reproduit ici d’après la transcription de Darmaing, journaliste du Constitutionnel, in Relation complète du sacre de Charles X, 1825, réimprimé avec une préface de L.Raillat, Paris, Communication et tradition, coll. " Archives des Bourbons ", 1996, p.56) . |
Cela déclencha une autre polémique. Dès le lendemain le Constitutionnel déclara : " Ces paroles établissent à jamais une polémique insurmontable entre le présent et le passé, répudient en quelque sorte les anciennes institutions de la monarchie absolue, qui sont mortes, pour adopter les nouvelles institutions de la monarchie constitutionnelle qui sont vivantes " (Constitutionnel, 30 mai 1825, cité par Raillat, op.cit., p.246) . En d’autres termes, à la polémique attachée à la question de savoir si Charles X allait ou non prononcer le terme de Charte dans son serment s’en substitua, dès le serment prêté, une autre, portant sur l’interprétation de la Charte : rupture ou prolongement du passé.
La place de l’Eglise
L’autre aspect, solidaire du premier, sur lequel se fixèrent les débats, était celui du rôle que la cérémonie allait attribuer à l’Eglise, assez impopulaire dans une bonne partie de la population. Cette préoccupation guida les travaux de la commission chargée de régler le cérémonial : il fallait à la fois maintenir les traditions et apporter les modifications en rapport avec les institutions nouvelles. On en trouve l’écho dans une lettre que Sosthène de La Rochefoucauld adressa dès le 15 novembre à Charles X, inquiétude portant notamment sur la question de la couronne : " (…) la légitimité, cette loi nationale, c’est d’elle seule que le Roi reçoit la couronne. Personne n’a le droit de la lui donner, ni même de la poser sur sa tête (…) Ne donnons rien de temporel à la religion ; ce qu’elle a de sublime, c’est d’être purement céleste. Ne remontons plus vers ce temps où le clergé pouvait dire au Roi : Nous vous avons élu. " Il ne faut rien donner d’autre à l’Eglise que la transcendance, contre le clergé qui affirme que c’est à lui de donner la couronne.
Cela a suscité un grand débat. Or la monarchie n’a pas pu calmer les esprits. Elle a pratiqué un double discours. Le discours officiel disait vouloir renouer la chaîne des temps moyennant toutes les concessions nécessaires. Le discours officieux était celui de l’expiation complète du crime du 21 janvier. Tout cela renvoyait à une certaine cacophonie, une confusion qui se manifesta dans la remise tardive des travaux de la commission chargée de réviser l’ordo. Nommée en novembre, elle ne remit ses conclusions que le 21 mai. Les modifications, bâclées, peu cohérentes, semblaient arbitraires. Cela entraînait un autre problème : les historiens ne savaient rien de l’ordo qui serait utilisée : pour décrire le sacre à l’avance, ils ont rabattu le déroulement du sacre de Charles X sur celui de Louis XVI, ce qui a encore compliqué la perception du sacre.
La poésie comme parole du sacre
Compte tenu de cette situation, la contribution de la poésie au sacre, comme parole du sacre, revêtait une importance considérable.
Le 1er juin, un entrefilet du Moniteur présenta à ses lecteurs un ouvrage consacré aux sacres du roi de France en louant son auteur d’avoir répandu " une nouvelle lumière sur l’origine, l’esprit, la raison, nous dirons presque les mystères d’une solennité qui est à la fois l’art le plus imposant, le spectacle le plus sublime et le reste le plus précieux de l’ancienne monarchie ".
Hugo fut l’officieux poète officiel de ce sacre. Dans la préface des Odes et Poésies diverses, Hugo proclamera " que l’histoire des hommes ne présente de poésie que jugée du haut des idées monarchiques et des croyances religieuses ". Or que représentait le sacre dans cette histoire des hommes, sinon l’incarnation même de cette conjonction sublime du monarchique et du religieux ?
Peu de poèmes posent explicitement la question du verbe poétique face à l’événement, mais nombreux sont ceux qui confessent leur impuissance à exprimer l’élévation des sentiments suscités par la cérémonie, et tout particulièrement l’enthousiasme du peuple. Alissan de Chazet reconnaît ainsi qu’il ne peut décrire ces transports d’enthousiasme, mais que tout un chacun peut les comprendre en songeant à ces deux points : il est un roi, vous êtes des Français - des hommes. La poésie est le médiateur pour faire sentir ces émotions, cette élévation.
Dans le Moniteur du 28 mai, le marquis de Valori retrace la veillée d’armes puis ajoute :
Franchissons, il est temps, franchissons le vieil âge,
Muse, l’allusion que voilait ton langage,
Se découvre, et j’entends crier :France, applaudis !
Les traits de CHARLES-CINQ restent à CHARLES-DIX.
La poésie a voulu conduire à la révélation de la continuité depuis Charles V, mais elle doit se taire devant le cri qui la manifeste.
Enfin, Maurice Ourry, dans le Moniteur du 29 mai, montre Delille, mort en 1813, accourant, dans un saint délire tributaire de la vertu de Charles, après celle de Louis dont il chanta " les royales douleurs ", et unissant sur son luth, par ces deux rois, les chants du ciel à ceux de la terre. Delille a renversé l’insupportable de la mort de Louis XVI. Mais si Louis n’a pas été béatifié, Delille l’est par Ourry. Puis le poème appelle le poète qui dira le bonheur du règne, celui qui pourra dire à Charles :
Roi dont on bénit la puissance,
A nos derniers neveux, d’avance
J’ai confié ton souvenir ;
Et, léguant ton règne à l’histoire,
Du bonheur de chanter ta gloire
J’ai déshérité l’avenir.
Ce poète léguera le règne à l’histoire, la déshéritant du dict. Eminence de la parole poétique, donc - forte " d’un noble orgueil, d’un pur amour " - qui seule pourra dire la grandeur du règne. Ce poète n’est pas encore là, il est à venir.
Le sacre du roi, chanté par le poète, vaut simultanément comme sacre du poète, ou du moins de la poésie, laquelle ne peut guère, n’aurait guère pu, en dernier ressort si le sacre avait " réussi ", se concevoir que comme huile sainte.
Une sociabilité fusionnelle
Cette suprême participation au spectacle le plus sublime revêt aussi un enjeu social : cette position extraordinaire faite au poète l’est aussi " socialement ", et il y a en effet une sociabilité fusionnelle du sacre.
Dans une lettre à se femme, Nodier donne une description pittoresque de Reims , " très belle ville où Paris s’est transporté par colonies (…) " et où " [I]l n’y a pas moyen de faire quatre pas sans avoir quelqu'un à embrasser [et] j’ai failli être étouffé ce matin. " Il ajoute : " Il y a d’ailleurs ici quelque chose d’étourdissant qui ressemble plus à un rêve qu’à une réalité ; cette confusion d’hommes et de choses, cette cohue de ministres, d’ambassadeurs, de poètes, de pairs de France, de préfets, de musiciens, de députés, de comédiens, de prélats, de journalistes, vivant tous sur le pied d’une égalité forcée et mangeant presque à la même table dans la même taverne ; cette multitude de rencontres inattendues qui reproduisent à tous moments tous les souvenirs de la vie (…) " Le Moniteur souligne la même chose : tout le monde est mêlé, les distances n’étant pas assez éloignées pour qu’on se serve d’équipages. Le sacre est aussi le moment de l’union du roi avec son peuple : c’est le thème des épousailles, qui renvoie à cette sociabilité de la fusion. Le Moniteur fera grand cas du fait que Charles X soit sorti sans escorte, sous la seule garde de son peuple enthousiaste.
Même si l’essentiel de la cérémonie est exclusive du peuple, et régie par un strict protocole, on ouvre à la fin portes de la cathédrale afin qu’il y pénètre, cependant que sont lâchés des centaines d’oiseaux, ce qu’on interprète souvent comme le symbole du peuple libre et joyeux. La chronique rapporte qu’il y est entré au milieu de vives acclamations. Il y eut cependant ce jour-là un incident : les oiseaux se sont brûlés à la flamme des lustres. Cela donna lieu à un échange. Le Drapeau blanc fit ce commentaire : " On s’est généralement communiqué à ce sujet une réflexion qui se présente d’elle-même à l’esprit, sur le funeste usage que fait de la liberté un peuple qui la reçoit tout à coup et avant qu’on ait éloigné ce qui peut lui nuire. " A quoi le Courrier français répondit qu’ " il est probable que les spectateurs se sont plutôt communiqués cette réflexion plus naturelle et moins ambitieuse, qu’il vaut mieux pour des oiseaux être lâchés en plein air que dans un lieu fermé où il y a des lustres et des candélabres. "